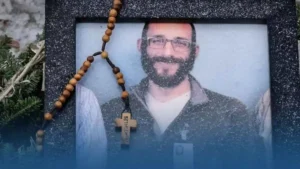La guerre au Sahel connaît un tournant technologique. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaida, utilise désormais des drones transformés en armes offensives, causant des pertes sévères aux armées du Mali et du Burkina Faso. Un rapport du Centre politique pour le Nouveau Sud, publié le 14 juillet, met en évidence cette montée en puissance des groupes armés dans l’usage de ces engins.
Une guerre aérienne low-cost
Depuis septembre 2023, plus de 30 attaques impliquant des drones ont été recensées, dont près de 82 % entre mars et juin 2025. L’attaque la plus meurtrière a eu lieu le 1er juin, contre la base militaire malienne de Boulikessi : le GSIM affirme avoir tué plus de 100 soldats en larguant des explosifs depuis des drones.
Initialement utilisés pour la reconnaissance, ces appareils sont désormais équipés de charges artisanales. « Ce ne sont pas des drones militaires sophistiqués, mais des modèles civils comme les DJI, disponibles en ligne ou en magasin pour quelques centaines d’euros. Les explosifs sont activés par téléphone portable », explique Rida Lyammouri, chercheur et coauteur du rapport.
L’apport de l’intelligence artificielle
L’IA permet à des non-spécialistes de modifier les logiciels embarqués, d’optimiser les trajectoires et de renforcer les drones pour transporter des charges plus lourdes. « De simples clés USB peuvent transférer des outils permettant de transformer ces engins en armes », précise Niccola Milnes, analyste et coautrice du rapport.
Cette approche s’inspire de l’usage intensif et peu coûteux des drones observé sur le front ukrainien. Des liens indirects existent : Kiev collabore depuis un an avec le Front de libération de l’Azawad (FLA), allié du GSIM, et certains anciens cadres rebelles, comme le colonel Hussein Ghulam, ont rejoint les rangs djihadistes en apportant leurs compétences techniques.
Un impact psychologique majeur
Le recours aux drones ne se limite pas à l’efficacité tactique. Il sert également de démonstration de force. Les gouvernements du Mali et du Burkina Faso ont acquis des drones militaires Bayraktar TB2 turcs, d’une valeur de 4,6 millions d’euros l’unité, mais en nombre limité une vingtaine pour les deux pays. Ces appareils sont utilisés pour surveiller et frapper, leurs images étant relayées par les médias d’État.
En réponse, les groupes armés publient leurs propres vidéos d’attaques, amplifiant l’effet psychologique de leurs actions et cherchant à prouver leur capacité à rivaliser.
Une menace régionale en expansion
« Le GSIM pourrait bientôt partager ses méthodes de modification des drones avec d’autres groupes sahéliens », prévient Rida Lyammouri. Le risque concerne non seulement les pays de l’Alliance des États du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger), mais aussi les États côtiers comme le Bénin et le Togo, où le groupe étend déjà son influence.
Paul Lamier Grandes Lignes