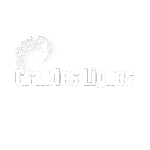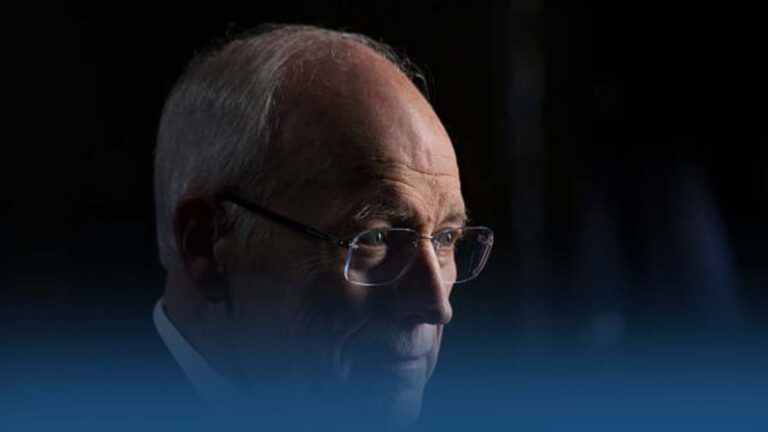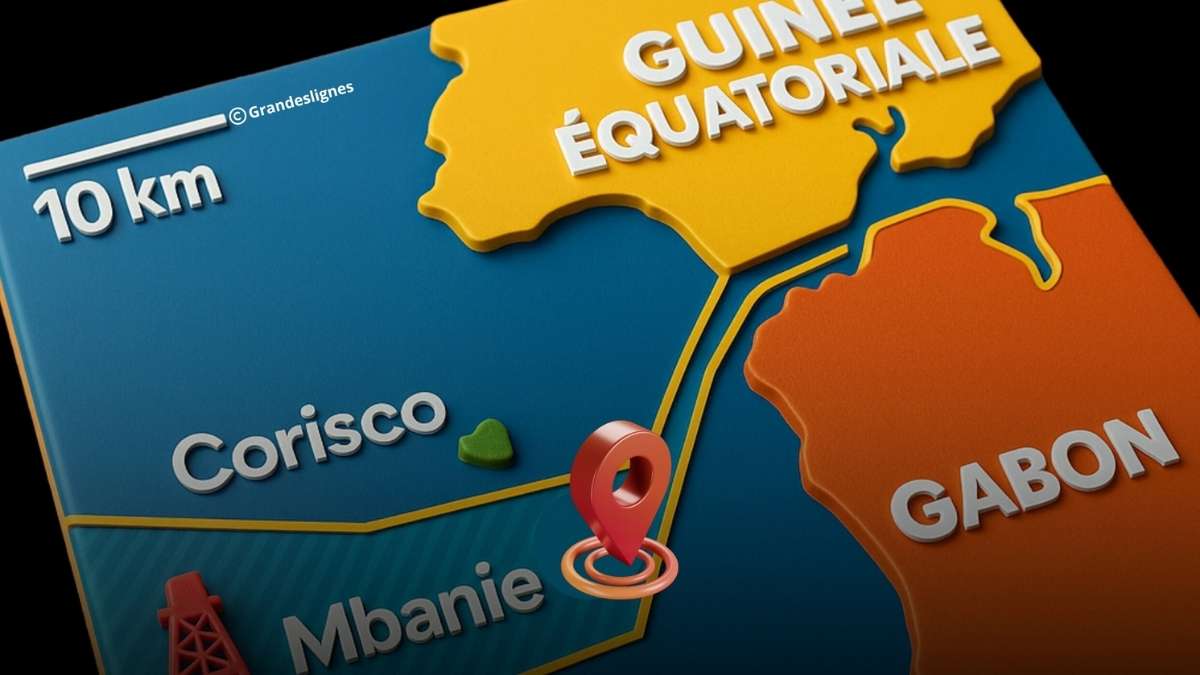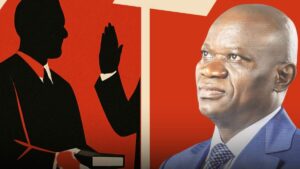Le président américain impose des droits de douane punitifs sur près de 90 pays, portant le taux moyen au plus haut depuis 1934. Les conséquences économiques commencent déjà à se faire sentir, aux États-Unis comme à l’international.
Une salve tarifaire sans précédent
Jeudi, juste après minuit, les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump sont entrés en vigueur. Près de 90 pays sont concernés, faisant grimper le taux tarifaire effectif moyen américain à plus de 18 %, son plus haut niveau depuis près d’un siècle.
Dans le Bureau ovale, le président a présenté cette décision comme une victoire politique et économique. Sur les réseaux sociaux, il a affirmé que « des milliards de dollars de tarifs affluent maintenant aux États-Unis », promettant d’aller plus loin si nécessaire.
Ces nouvelles taxes interviennent après une série de décrets augmentant les taux et scellant des accords commerciaux préliminaires avec l’Union européenne et d’autres partenaires.
Les marchés prudents, l’inflation à l’horizon
Si Wall Street a peu réagi le S&P 500 ne reculant que légèrement, les économistes redoutent un impact plus lourd dans les mois à venir. Déjà, le coût de certains biens importés augmente : électroménager, vêtements, meubles.
Le Budget Lab de l’université Yale estime que ces droits pourraient coûter en moyenne 2 400 dollars par an aux ménages américains et retrancher un demi-point de pourcentage à la croissance dès 2025.
Olu Sonola, de Fitch Ratings, prévient : « Nous commençons tout juste à voir les effets des précédents tarifs. Avec cette nouvelle vague, l’impact sera amplifié. »
Des hausses ciblées, mais massives
Les nouveaux droits commencent à 15 % pour les importations en provenance de pays comme la Bolivie, l’Équateur, l’Islande ou le Nigeria. Taïwan est frappé à 20 %, tandis que le Brésil voit certaines de ses exportations taxées à 50 %, en représailles à des poursuites judiciaires contre l’ancien président Jair Bolsonaro, proche de Donald Trump.
Un tarif de 35 % vise certains produits canadiens, hors accord États-Unis–Mexique–Canada. Les droits sur les produits chinois restent fixés à 30 % dans le cadre d’un accord bilatéral, mais la trêve expire le 12 août avec la possibilité d’une extension de 90 jours.
L’administration envisage également un tarif de 100 % sur les semi-conducteurs étrangers, avec exemption pour les entreprises produisant aux États-Unis.
Les répercussions diplomatiques
Dans plusieurs capitales, la réaction est vive. L’Inde, visée par un doublement prochain de ses droits, a dénoncé « une intimidation » et affirmé qu’elle ne céderait pas. En Asie du Sud-Est, les gouvernements s’inquiètent des effets sur leurs industries exportatrices.
En Europe, l’UE a accepté un accord préliminaire pour éviter les hausses les plus fortes, en échange d’un accès élargi pour les produits américains et d’investissements dans l’industrie américaine sans que les détails soient rendus publics.
Un risque de “stagflation”
Pour Mark Zandi, chef économiste chez Moody’s Analytics, la combinaison d’une croissance faible et d’une inflation importée pourrait plonger les États-Unis dans un scénario « très stagflationniste ».
Les entreprises américaines, qui avaient anticipé ces mesures en augmentant leurs stocks, commencent à écouler leurs inventaires. Mais la hausse des prix devrait s’accélérer dans les prochains mois, selon Matthew Martin, d’Oxford Economics.
Ces tarifs ne sont probablement qu’une étape. La Maison Blanche envisage déjà de cibler les pays qui achètent du pétrole à la Russie, espérant ainsi réduire les revenus du Kremlin et influencer la guerre en Ukraine.
Donald Trump menace aussi d’imposer des taxes supplémentaires sur les médicaments étrangers, les puces électroniques et d’autres produits stratégiques. Les tribunaux fédéraux devraient bientôt être saisis de recours contre certaines de ces mesures.
Pour l’heure, la “guerre commerciale élargie” du président américain ouvre une nouvelle phase d’incertitude pour l’économie mondiale. Et si les États-Unis ont jusqu’ici évité la récession, beaucoup d’économistes estiment que la facture pourrait être salée et durable.
Adonis Kanga Grandes Lignes