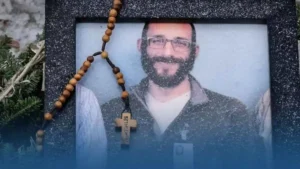Dick Cheney, vice-président de George W. Bush et architecte de la guerre en Irak, s’est éteint à l’âge de 84 ans. Homme d’influence et stratège redouté, il restera l’un des personnages les plus controversés de l’histoire politique américaine contemporaine.
Un stratège redouté de Washington
L’ancien vice-président des États-Unis Dick Cheney est décédé lundi des suites de complications liées à une pneumonie et à des maladies cardiaques, selon un communiqué de sa famille. Âgé de 84 ans, il avait longtemps lutté contre des problèmes coronariens, survivant à cinq crises cardiaques entre 1978 et 2010. Depuis 2001, il vivait avec un dispositif médical pour réguler son rythme cardiaque.
Homme discret mais influent, Cheney a été considéré comme l’un des vice-présidents les plus puissants de l’histoire américaine. Sa capacité à tirer les ficelles du pouvoir depuis les coulisses lui avait valu une réputation d’architecte invisible des décisions majeures de l’administration Bush.
De Ford à Bush : un long parcours politique
Dick Cheney débute sa carrière politique à la Maison Blanche sous Gerald Ford, dont il devient le chef de cabinet après avoir remplacé Donald Rumsfeld. Il participe ensuite à la campagne de réélection du président républicain en 1976, perdue face à Jimmy Carter.
Élu représentant du Wyoming en 1978, il occupe son siège pendant dix ans avant d’être nommé ministre de la Défense par George H. W. Bush. À ce poste, il dirige le Pentagone pendant la guerre du Golfe de 1990-1991, consolidant son image de stratège militaire et de défenseur d’une Amérique forte.
En 1995, il prend la tête du géant pétrolier Halliburton, où il restera jusqu’à sa nomination comme colistier de George W. Bush pour la présidentielle de 2000.
L’homme derrière la guerre en Irak
Vice-président de 2001 à 2009, Cheney a marqué la politique américaine de son empreinte. Après les attentats du 11 septembre, il pousse à une riposte immédiate contre le terrorisme, influençant la décision d’envahir l’Afghanistan, puis l’Irak dix-sept mois plus tard.
Son rôle dans la justification de l’invasion de l’Irak, fondée sur des soupçons d’armes de destruction massive qui ne seront jamais prouvés, lui vaudra de vives critiques. Cheney n’a jamais renié sa position, affirmant jusqu’à la fin de sa vie croire que Saddam Hussein poursuivait un programme clandestin.
Halliburton, l’entreprise qu’il dirigeait avant d’entrer à la Maison Blanche, bénéficiera largement des contrats liés à la reconstruction irakienne, alimentant les soupçons de conflit d’intérêts.
Un partisan des méthodes dures
Cheney a été l’un des plus fervents défenseurs des méthodes d’interrogatoire extrêmes appliquées par les États-Unis dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme ». Des pratiques désormais reconnues comme de la torture, mais qu’il continuait à justifier au nom de la sécurité nationale.
La guerre d’Irak aura coûté la vie à près de 5 000 soldats américains, tandis que celle d’Afghanistan, prolongée jusqu’en 2021, a entraîné la mort de plus de 2 300 militaires.
Une fin de vie marquée par la rupture avec Trump
Figure historique du Parti républicain, Dick Cheney avait surpris en 2024 en annonçant son soutien à la démocrate Kamala Harris face à Donald Trump, qu’il jugeait « inapte à exercer la fonction présidentielle ». « Nous avons le devoir de placer le pays au-dessus des clivages partisans », avait-il déclaré alors.
Ce geste symbolisait la distance grandissante entre l’ancien faucon de Washington et la nouvelle droite américaine.
Paul Lamier Grandes Lignes avec (AFP)