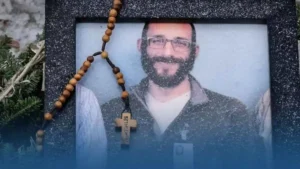Alors que le Brésil vient de condamner Jair Bolsonaro à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État, les États-Unis ont, eux, réélu Donald Trump. Deux réponses radicalement opposées à un même péril démocratique.
Le contraste est saisissant. Jeudi, la Cour suprême brésilienne a condamné l’ancien président Jair Bolsonaro à 27 ans de prison pour avoir tenté de renverser l’élection de 2022. Une décision historique, sans équivalent dans l’histoire récente des démocraties occidentales. En face, aux États-Unis, Donald Trump qui a lui aussi tenté d’annuler une élection a non seulement échappé aux poursuites, mais vient de retrouver le chemin de la Maison Blanche.
C’est tout un symbole : alors que le Brésil punit l’autoritarisme, l’Amérique le reconduit au pouvoir.
Une justice qui tranche au Brésil
La condamnation de Jair Bolsonaro marque un tournant pour le Brésil. Accusé d’avoir orchestré un complot militaire afin d’empêcher la transition démocratique après sa défaite face à Lula, l’ancien président d’extrême droite devient le premier chef d’État brésilien à être condamné pour tentative de coup d’État.
Selon les éléments présentés au tribunal, Bolsonaro aurait non seulement encouragé l’insurrection du 8 janvier 2023 qui a vu ses partisans prendre d’assaut le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel mais également envisagé l’assassinat de Lula et d’autres responsables.
Au cœur du dispositif judiciaire brésilien : le juge Alexandre de Moraes, figure emblématique de la résistance institutionnelle. Dès l’élection de Bolsonaro en 2018, Moraes a mis en place une série de mesures destinées à surveiller les réseaux de désinformation et à contenir les pulsions autoritaires du pouvoir. Son activisme judiciaire, parfois critiqué, a pourtant permis de protéger les fondations démocratiques du pays.
Aux États-Unis, l’impunité d’un président
Outre-Atlantique, le contraste est saisissant. Donald Trump, battu en novembre 2020, a refusé d’accepter sa défaite, a incité ses partisans à marcher sur le Capitole le 6 janvier 2021, et a multiplié les pressions sur les responsables électoraux. Pourtant, aucune sanction judiciaire ou politique n’a véritablement abouti.
Le Congrès a bien tenté de le destituer, sans succès. Le ministère de la Justice, longtemps silencieux, l’a inculpé en 2023, mais la Cour suprême a bloqué les procédures en lui accordant une large immunité. Moins d’un an plus tard, Trump revient au pouvoir.
Washington sanctionne… le Brésil
Ironie supplémentaire : au lieu de saluer la résilience démocratique du Brésil, l’administration Trump a choisi de le sanctionner. Dès l’annonce du procès de Bolsonaro, Washington a imposé des droits de douane massifs sur les exportations brésiliennes, sanctionné des juges dont Alexandre de Moraes et assimilé la procédure judiciaire à une “chasse aux sorcières”.
Une stratégie de pression d’État à État, inédite entre deux démocraties, qui renoue avec les pratiques interventionnistes les plus controversées de la guerre froide.
Leçon d’Amérique latine
Si les deux pays ont été confrontés à des menaces similaires une poussée autoritaire venue du sommet de l’État, leurs réactions illustrent deux philosophies de la démocratie.
Le Brésil, marqué par la dictature militaire de 1964-1985, semble avoir intégré une culture de vigilance. Le pouvoir judiciaire a refusé de céder, les institutions ont assumé un rôle actif de rempart. La société politique a, dans l’ensemble, accepté cette décision, voyant dans l’élimination de Bolsonaro un moyen de tourner la page et de reconstruire.
Aux États-Unis, au contraire, les institutions ont hésité, reculé, négocié. Le système politique, paralysé par la polarisation, n’a pas su s’opposer à la reconquête de Trump.
L’Amérique devrait-elle s’inspirer du Brésil ?
L’affaire Bolsonaro démontre que la démocratie ne se défend pas seule. Elle exige des institutions solides, mais surtout du courage politique. Le Brésil, aujourd’hui, montre la voie en tenant un ancien président responsable. Les États-Unis, eux, apparaissent de plus en plus comme un géant fragilisé, prisonnier de ses compromis.
En retour, Washington semble prêt à punir ceux qui osent faire ce qu’il n’a pas su faire.
Paul Lamier Grandes Lignes