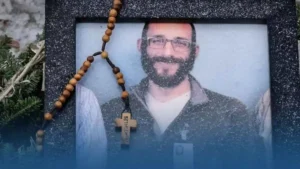En s’adressant au congrès de l’Union sacrée, Félix Tshisekedi a rappelé que l’initiative de tout dialogue dépendait exclusivement de lui. Plus qu’un simple rappel protocolaire, cette déclaration consacre sa volonté de maîtriser le calendrier politique et de se poser comme arbitre unique des rapports de force.
En République démocratique du Congo, où le mot « dialogue » renvoie à l’histoire des compromis nationaux censés dénouer les crises, cette posture prend un sens particulier : il ne s’agit pas d’un refus, mais d’un verrouillage du processus.
Cette position, qui place le processus sous son contrôle, éclaire la manière dont il entend gérer les équilibres politiques d’ici 2028.
Le président maître du calendrier
En se réservant le droit de lancer ou non un dialogue, le chef de l’État confirme sa volonté de garder la maîtrise du calendrier politique. Dans un pays où les dialogues nationaux ont souvent permis de résoudre des crises institutionnelles, ce rappel marque une continuité avec l’histoire politique congolaise, tout en recentrant la décision au sommet de l’État.
Les enjeux du report
Un dialogue ouvert trop tôt pourrait impliquer des concessions : élargissement du gouvernement, ajustements institutionnels ou compromis politiques. En différant cette perspective, Félix Tshisekedi conserve une marge de manœuvre plus large et préserve l’équilibre actuel de ses alliances. La question d’un dialogue en fin de mandat reste toutefois présente, certains acteurs y voyant un possible cadre de négociation pour préparer l’après-2028.
Un outil politique récurrent
Officiellement, le dialogue est présenté comme une solution de stabilisation. Mais dans les faits, il est devenu une arme politique : un outil pour rassurer l’opinion et les partenaires extérieurs, tout en évitant l’imprévisible des négociations.
La méthode n’est pas nouvelle en RDC. De Mobutu à Kabila, les dialogues ont souvent servi à prolonger un règne plus qu’à ouvrir une véritable alternance. Tshisekedi reprend ce schéma, en en faisant un instrument de gestion plutôt qu’un espace de changement. La posture actuelle du président s’inscrit dans cette tradition : maintenir l’idée du dialogue comme option, sans en préciser les contours immédiats.
Une attente de la société civile
Pour une partie de la population et des organisations citoyennes, le dialogue reste perçu comme un mécanisme de sortie de crise ou de consolidation démocratique. Mais son efficacité dépendra des conditions dans lesquelles il serait convoqué et de la volonté des acteurs politiques de s’y engager de manière constructive. Sans vigilance de la société civile et des forces politiques, il risque de se réduire à un écran de fumée.
Entre continuité et incertitude
À ce stade, Félix Tshisekedi n’a pas donné de calendrier précis. L’horizon 2028 apparaît comme une échéance clé, où la question d’un dialogue national pourrait être relancée. Reste à savoir s’il s’agira d’un outil de stabilisation politique ou d’un cadre plus large de transition.
Paul Lamier Grandes Lignes