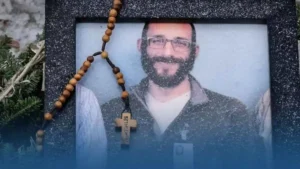L’intensification des frappes israéliennes sur l’Iran provoque une onde de choc jusque dans les cercles stratégiques russes. En plein redéploiement d’influence au Moyen-Orient, le Kremlin voit dans l’affaiblissement de Téhéran une menace directe pour ses intérêts géopolitiques et économiques. De nombreuses voix, dans la presse comme chez les analystes, tirent la sonnette d’alarme.
Depuis plusieurs jours, les médias proches du pouvoir à Moscou rapportent les bombardements israéliens sur des positions iraniennes. Pour Novyé Izvestia, ces attaques massives révèlent une volonté de « démantèlement complet » de la République islamique, sous couvert de neutralisation nucléaire. Un scénario perçu comme dangereux pour la Russie, qui considère Téhéran comme un levier régional essentiel, notamment pour contenir les instabilités au Caucase et protéger ses corridors d’influence.
Du côté de Ria Novosti, le ton se veut plus mesuré. Le média d’État tente de relativiser la probabilité d’un conflit ouvert et rappelle la capacité de défense iranienne, qualifiant le pays de puissance régionale robuste, bien différente de l’Irak ou de la Somalie.
Pourtant, dans les milieux politiques russes, les inquiétudes grandissent. Mikhaïl Kassianov, ancien Premier ministre, évoque un affaiblissement stratégique de la position russe au Moyen-Orient. Avec la Syrie déjà largement échappée à l’influence de Moscou, la perte de l’Iran remettrait en question les ambitions régionales du Kremlin. L’accord de coopération signé entre les deux pays en janvier dernier pourrait ne pas survivre à un effondrement de la République islamique.
Le volet économique est également sous tension. Les ambitions affichées par Mourad Sadygzade 30 milliards de dollars d’échanges commerciaux d’ici 2030 semblent aujourd’hui compromises. La perspective d’une désorganisation régionale, combinée à une potentielle fermeture du détroit d’Ormuz, alimente les craintes d’une crise énergétique. Un bénéfice à court terme pour la Russie pourrait ainsi se transformer en casse-tête logistique, diplomatique et financier à moyen terme.
Certaines voix, comme celle du politologue Andreï Kortounov, voient néanmoins dans ce conflit une occasion de diversion : en concentrant l’attention occidentale sur le Moyen-Orient, Moscou pourrait espérer desserrer la pression en Ukraine. Mais cette lecture optimiste reste fragile. Un changement de régime à Téhéran, moins favorable au partenariat avec Moscou, serait un revers stratégique difficile à compenser.
Dmitry Bridzhe, analyste cité dans Moskovskaïa Gazeta, souligne quant à lui les risques d’enlisement pour la diplomatie économique russe. La hausse des primes d’assurance, la fragilisation des routes commerciales et l’incertitude sécuritaire pèsent déjà sur les investissements dans le corridor Nord-Sud, cher au Kremlin.
Au final, la Russie pourrait bien se retrouver spectatrice d’un basculement régional qui mettrait à mal plusieurs années d’efforts diplomatiques. Loin de se réjouir des frappes israéliennes, Moscou mesure les pertes potentielles d’un conflit qu’elle ne contrôle pas.
Paul Lamier Grandes Lignes