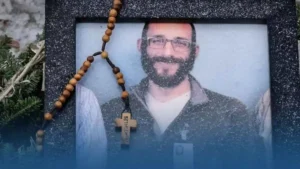À Antananarivo, le cycle du pouvoir se referme. Quinze ans après avoir renversé un président avec l’appui de l’armée, Andry Rajoelina subit à son tour le même sort. Le chef de l’État malgache a été destitué mardi, après que les militaires ont annoncé la suspension de la Constitution et la mise en place d’un comité de transition.
Une destitution orchestrée par la rue et l’armée
Mardi 14 octobre, la scène politique malgache a basculé.
Quelques heures après le vote de destitution du président par l’Assemblée nationale, le colonel Michael Randrianirina, chef de la Capsat (Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques), a proclamé la prise du pouvoir depuis le palais présidentiel d’Antananarivo.
« On va prendre le pouvoir à partir d’aujourd’hui. Le Sénat et la Haute Cour constitutionnelle sont dissous. L’Assemblée nationale, elle, continuera à travailler », a-t-il déclaré au micro de l’AFPTV.
La Haute Cour constitutionnelle a ensuite constaté la vacance du pouvoir et invité « l’autorité militaire compétente » incarnée par le colonel Randrianirina à exercer les fonctions de chef de l’État. Dans la capitale, les scènes de liesse ont rapidement envahi la place du 13-Mai, lieu hautement symbolique des révoltes populaires malgaches. Drapeaux, chants et feux d’artifice ont marqué ce que beaucoup considèrent comme la chute définitive du régime Rajoelina.

Rajoelina, le président renversé par son propre scénario
Ironie du destin : Andry Rajoelina subit aujourd’hui le sort qu’il avait infligé à son prédécesseur en 2009. Celui qui fut présenté comme un « jeune président moderne » est désormais accusé d’avoir perdu le contact avec la rue et de gouverner dans un isolement croissant.
Contesté par la jeunesse et abandonné par l’armée, le chef de l’État, dont la localisation demeure inconnue, dénonce une « tentative de coup d’État » et affirme rester « pleinement en fonction ». Des rumeurs, relayées par RFI, font état de son exfiltration par un avion militaire français, information que la présidence n’a pas confirmée.
La rupture entre le pouvoir civil et les militaires était visible depuis plusieurs semaines. La Capsat, fer de lance du putsch de 2009, avait déjà annoncé qu’elle « refuserait de tirer » sur les manifestants, avant de rallier ouvertement la contestation.
Une insurrection portée par la jeunesse
Le mouvement de contestation est né fin septembre, dans un contexte d’exaspération sociale extrême.
C’est la génération Z malgache, jeune, connectée et instruite, qui a allumé la mèche, protestant contre les coupures d’eau et d’électricité, la corruption et le coût de la vie. Rapidement, les fonctionnaires et syndicats se sont joints à la mobilisation.
« Je suis vraiment très heureuse, en tant que jeune, ici à Madagascar, on est libre maintenant. On a obtenu la victoire », confie Jouannah Rasoarimanana, 24 ans, comptable, présente sur la place du 13-Mai.
Pour beaucoup, cette victoire est celle d’une génération frustrée par la stagnation politique et économique d’un pays où 80 % des habitants vivent avec moins de 3 euros par jour.
L’armée, arbitre et garant autoproclamé
Dans son allocution, le colonel Randrianirina a annoncé la création d’un comité de transition composé d’officiers de l’armée, de la gendarmerie et de la police, avec une participation civile envisagée. Un gouvernement civil devrait suivre « dans les prochains jours ».
Cette formule, déjà utilisée lors des transitions précédentes, consacre une constante malgache : l’armée reste l’arbitre ultime du pouvoir politique.
Sous couvert de stabilité, elle assume une fonction de tutelle sur des institutions civiles fragiles, souvent paralysées par les rivalités politiques ou la corruption.
Mais cette fois, le coup de force bénéficie d’un soutien populaire massif, nourri par des années de désillusion.
Une crise institutionnelle totale
Avec la suspension de la Constitution et la dissolution des principales institutions régaliennes, Madagascar entre dans une zone d’instabilité juridique et politique.
Les précédents coups d’État (1972, 1991, 2009) ont toujours débouché sur de longues transitions militaires, souvent suivies de cycles de crise et de reconstruction avortés.
« On essaie de voir exactement ce qui va se passer une fois la poussière retombée. Évidemment, s’il y a un coup d’État en cours, on s’y opposera », a déclaré Farhan Haq, porte-parole du secrétaire général de l’ONU.
La SADC (Communauté de développement d’Afrique australe) et l’Union africaine ont, de leur côté, appelé à la retenue et au retour à l’ordre constitutionnel.
Un pays pris dans le piège de la pauvreté et du pouvoir
Malgré sa richesse naturelle minerais, biodiversité, tourisme, Madagascar reste l’un des pays les plus pauvres du monde. L’économie informelle domine, les infrastructures sont délabrées et la dépendance à l’aide internationale demeure chronique.
Le retour de l’armée ne résout rien : il ne fait que traduire l’échec du politique à répondre aux aspirations de la jeunesse et à construire des institutions solides.
À chaque crise, l’île espère une refondation, mais chaque transition se solde par une désillusion.
Cette fois encore, la prise de pouvoir militaire n’annonce pas une nouvelle ère, mais la continuité d’un cycle où le pouvoir se conquiert plus souvent dans la rue que dans les urnes.
Emmanuel Christ SN avec (AFP)