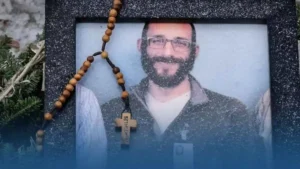Alors que les frappes israéliennes contre l’Iran s’intensifient et que Washington est désormais militairement impliqué, un acteur discret mais central du paysage géopolitique régional reste largement silencieux : le monde arabe sunnite. À la fois spectateurs prudents et bénéficiaires potentiels, les États arabes du Golfe et d’ailleurs observent avec un intérêt mêlé d’inquiétude le duel entre Téhéran et ses adversaires israélo-américains.
La chute partielle ou totale de l’infrastructure militaire iranienne, et peut-être demain de son régime, serait pour certains dirigeants arabes l’aboutissement d’un rapport de forces longtemps redouté mais secrètement souhaité. Depuis des décennies, la République islamique s’est imposée comme un facteur déstabilisateur au Proche-Orient, via son réseau de groupes armés, de mandataires et de milices du Liban à Gaza, en passant par la Syrie, l’Irak et le Yémen. Mais aujourd’hui, l’Iran doit faire face seul, directement frappé sur son sol, sans l’interposition de ses proxies habituellement mobilisés pour absorber les coups.
Une posture calculée : ni soutien franc, ni condamnation ferme
Malgré l’indignation de façade, les condamnations diplomatiques et les appels au calme, le soulagement discret domine dans les capitales sunnites. En tête, les pétromonarchies du Golfe, traditionnellement en tension avec Téhéran, voient dans l’affaiblissement du régime chiite une aubaine géopolitique majeure. Plus que tout, elles espèrent la disparition des menaces pesant sur leurs infrastructures énergétiques cibles récurrentes des frappes ou des sabotages téléguidés par l’Iran ou ses alliés.
Mais cet enthousiasme reste mesuré. Car à la victoire potentielle d’Israël ou des États-Unis contre la République islamique, succède la crainte d’un vide de pouvoir incontrôlable à Téhéran, de flux migratoires vers les pays du Golfe, ou de chaos régional comparable aux suites des printemps arabes. C’est la grande inquiétude exprimée à mots couverts, notamment par la Turquie, qui redoute une onde de choc migratoire en provenance d’un Iran en déliquescence. Cette crainte résonne aussi en Europe.
Un calcul à double tranchant
Le renversement du régime iranien pourrait rebattre les cartes énergétiques et géopolitiques. L’Iran, libéré des sanctions, pourrait redevenir un mastodonte gazier et pétrolier sur les marchés mondiaux, capable de concurrencer les exportateurs actuels, au premier rang desquels figurent les États du Conseil de coopération du Golfe. L’ambivalence est donc profonde : voir l’Iran affaibli militairement et politiquement, oui mais pas au point de le voir renaître en puissance économique stabilisée, en position de force face à ses voisins sunnites.
Au Liban, l’effacement du Hezbollah est vu avec un mélange de soulagement et d’inquiétude. Le parti chiite, longtemps perçu comme une excroissance iranienne sur le territoire libanais, a régné par la peur et la coercition. Mais son affaiblissement laisse aussi un vide sécuritaire. Même ambivalence en Syrie, où l’effondrement de l’influence iranienne a ouvert la voie à de nouvelles forces locales, parfois soutenues en sous-main par Israël.
L’alternative sunnite au modèle chiite ?
Dans les esprits stratégiques du monde sunnite, l’effondrement potentiel du régime des mollahs pose une question de fond : que reste-t-il du projet de République islamique comme modèle alternatif à la sécularisation autoritaire ou aux monarchies conservatrices du monde arabe ? Si le chiisme iranien vacille, la légitimité religieuse d’un contre-pouvoir islamiste à vocation révolutionnaire pourrait être emportée avec lui.
Mais les souvenirs des printemps arabes et de leurs débordements tragiques guerres civiles, autoritarismes renforcés, fragmentation sont toujours vifs. Le souvenir irakien, où la chute brutale du régime de Saddam Hussein a laissé place à un chaos durable, hante désormais aussi les opposants iraniens eux-mêmes, qui, tout en rejetant le régime des mollahs, redoutent une transition sanglante et désorganisée.
Et demain ? Deux scénarios possibles
Tout dépendra de la capacité de riposte de l’Iran. Si la République islamique continue à frapper Israël de manière significative, elle conservera un prestige régional qui pourrait galvaniser les opposants aux normalisations diplomatiques entre pays arabes et Israël. À l’inverse, si Téhéran épuise ses stocks ou si ses capacités de frappe sont anéanties, une recomposition s’ouvrira peut-être autour de figures issues de l’ancien régime, prêtes à négocier avec Washington et à se repositionner dans un nouvel ordre régional.
Les États arabes sunnites, en position d’observateurs et de juges silencieux, continueront d’évaluer avec pragmatisme les risques et les opportunités de chaque évolution sur le champ de bataille. Leur ligne de conduite, comme souvent dans la région, reste fondée sur le maintien d’un équilibre instable, où l’ennemi d’hier pourrait redevenir demain un concurrent… ou un allié de circonstance.
Paul Lamier Grandes Lignes