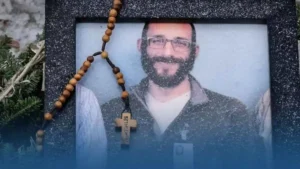Le ton américain sur Taïwan a changé. Jusqu’ici, Washington affirmait qu’une invasion par la Chine n’était ni imminente ni inévitable. Mais le 31 mai, lors du Dialogue Shangri-La à Singapour, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que la menace d’une agression militaire de Pékin pourrait désormais être « imminente ». Un signal direct à la Chine, mais aussi un message de réassurance à des alliés asiatiques inquiets du cap pris par la politique étrangère américaine sous la présidence Trump.
Un discours plus ferme
Lors de sa première intervention à ce sommet de sécurité organisé par l’Institut international d’études stratégiques, M. Hegseth a exposé un diagnostic alarmant : Pékin renforcerait activement ses capacités militaires dans l’objectif de conquérir Taïwan d’ici 2027. Il a évoqué des manœuvres militaires répétées autour de l’île, du harcèlement maritime envers les Philippines, et une volonté affichée par la Chine de changer l’équilibre régional par la force. Une invasion, a-t-il estimé, aurait des conséquences « dévastatrices » pour l’Asie et au-delà.
Mais l’évaluation américaine demeure controversée. Certains responsables occidentaux relativisent l’échéance de 2027 et soulignent l’absence de signaux concrets indiquant une attaque imminente. Parmi les obstacles cités : le manque d’équipements amphibies côté chinois et les purges au sein de l’Armée populaire de libération, interprétées comme un signe de défiance du président Xi Jinping envers ses cadres militaires.
Du côté chinois, l’absence du ministre de la Défense Dong Jun au sommet a été remarquée. Mais la réponse est venue du contre-amiral Hu Gangfeng, représentant de l’Université de défense nationale, qui a qualifié les propos américains de provocateurs. Selon lui, les déclarations de M. Hegseth viseraient à semer la division dans la région.
Le secrétaire américain à la Défense a cependant poursuivi son discours en réaffirmant l’engagement des États-Unis dans la région indopacifique. Il a martelé qu’aucune tentative de modifier le statu quo par la force ne serait tolérée, en particulier dans la « première chaîne d’îles » allant du Japon à la Malaisie.
Malgré la posture affichée à Singapour, des doutes persistent sur la cohérence de la stratégie américaine. Plusieurs éléments nuisent à la crédibilité du message : le président Trump a déjà accusé Taïwan de « voler » l’industrie des semi-conducteurs, et ses proches conseillers ont parfois minimisé l’importance stratégique d’un conflit dans le détroit de Taïwan.
L’imposition puis le retrait de droits de douane contre la Chine, ainsi que les hésitations sur la réaction à adopter en cas d’agression, nourrissent une perception d’imprévisibilité. M. Hegseth lui-même, figure médiatique venue de Fox News, est connu pour ses prises de position tranchées sur les questions militaires, parfois au détriment de la diplomatie.
Un repositionnement partiel des alliances
Au sommet de Singapour, M. Hegseth a tenté de réaffirmer la valeur des alliances, qualifiant le réseau américain en Asie d’« avantage stratégique ». Il a toutefois aussi affirmé que les Européens devaient se concentrer sur leur propre théâtre d’opérations et éviter les patrouilles en mer de Chine. Une position qui contraste avec celle de plusieurs hauts responsables militaires américains, plus favorables à un soutien transatlantique élargi dans l’Indopacifique.
Divergences avec les alliés
Le président français Emmanuel Macron, également présent à Singapour, a illustré la prudence européenne face à l’escalade. Il a plaidé pour une « coalition d’action » euro-asiatique axée sur la coopération économique, tout en admettant qu’une réponse militaire européenne en cas de guerre dans la région serait improbable. « Tout le monde sera très prudent », a-t-il glissé, en référence non dissimulée à l’attitude possible des États-Unis eux-mêmes.
M. Hegseth, de son côté, a réaffirmé que « la Chine communiste n’envahirait pas Taïwan » sous le mandat de M. Trump. Une promesse fondée, selon des proches du secrétaire à la Défense, sur des échanges privés avec le président américain. Mais en filigrane, une inquiétude demeure : Donald Trump penserait que Pékin passera à l’action après son départ.
Valerie Ndour Grandes Lignes