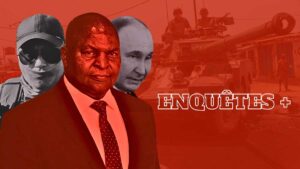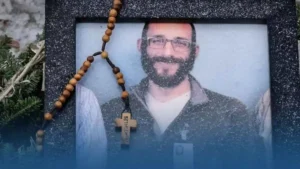La capitale américaine, conçue comme vitrine de la démocratie, est aujourd’hui le théâtre d’une démonstration de pouvoir présidentiel qui soulève des inquiétudes
Washington, D.C., avec ses larges boulevards, ses bâtiments de marbre blanc et ses monuments emblématiques, a toujours voulu incarner la grandeur démocratique des États-Unis. Mais cette semaine, c’est une tout autre image qui s’est imposée : celle des instincts autoritaires de Donald Trump.
Le 11 août, depuis la salle de presse de la Maison-Blanche, le président américain a décrit la capitale comme une ville « envahie par des gangs violents et des criminels assoiffés de sang », avant d’annoncer le déploiement de la Garde nationale et la prise de contrôle de la police municipale. Il a également promis de « se débarrasser des bidonvilles » et d’expulser les sans-abri.
Un geste politique aux airs de précédent
Ce n’est pas la première fois que Donald Trump emploie les forces armées pour l’application de la loi civile dans une ville qu’il critique ouvertement. En 2020, il avait ordonné la dispersion des manifestants de Black Lives Matter à Washington, et plus récemment, il avait envoyé la Garde nationale à Los Angeles lors de manifestations contre les raids d’immigration sans demande des autorités locales.
La situation est toutefois particulière à Washington : son statut de district fédéral permet au président de contrôler directement sa Garde nationale et de prendre temporairement la main sur la police municipale. Ailleurs, il lui faudrait franchir des obstacles juridiques bien plus élevés.
Un impact pratique limité
Environ 200 soldats de la Garde nationale de D.C., dont les effectifs sont modestes, viendront en soutien aux forces de l’ordre locales. Par la loi, cette prise de contrôle ne peut durer plus de 30 jours sans l’aval du Congrès, ce qui rend improbable une mainmise durable.
Pour justifier son action, Donald Trump cite plusieurs agressions récentes visant des fonctionnaires fédéraux : coups de feu mortels contre un stagiaire du Congrès, détournements de voitures violents, agressions à l’arme blanche… Des faits qui nourrissent son discours sécuritaire.
Une réalité criminelle plus nuancée
Si la criminalité violente a bondi en 2023, les chiffres montrent un recul cette année : le taux d’homicides revient vers son niveau d’avant la pandémie, et les détournements de voitures, bien qu’encore élevés, diminuent. La capitale est aujourd’hui nettement plus sûre que dans les années 1990 et un peu moins dangereuse qu’il y a dix ans.
Pour ses critiques, l’initiative du président est d’autant plus malvenue que lui et ses alliés républicains ont souvent bloqué le financement local de la police et d’autres services, aggravant indirectement les problèmes de sécurité.
Un coup politique plus qu’une politique de sécurité
L’accent mis par Donald Trump sur Washington, plutôt que sur d’autres villes plus touchées par la criminalité, s’explique par la latitude que lui donne le statut fédéral de la capitale. Mais reproduire cette stratégie ailleurs exigerait d’invoquer la loi sur l’insurrection un geste politiquement explosif, utilisé pour la dernière fois en 1992.
En ciblant la capitale, le président frappe là où il dispose de pouvoirs exceptionnels, envoyant un message politique fort… mais qui pourrait accentuer la fracture entre le gouvernement fédéral et les 700 000 habitants de Washington, déjà privés de pleine autonomie.
Paul Lamier Grandes Lignes