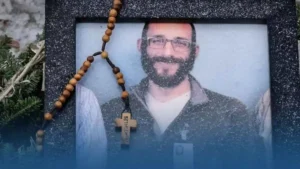Les nouvelles taxes douanières imposées par l’administration Trump ne visent pas seulement la Chine, l’Union européenne ou le Vietnam. Elles secouent jusqu’aux confins du continent africain, souvent perçu comme marginal dans les grandes stratégies commerciales mondiales. Mais ce coup de tonnerre tarifaire, d’une brutalité inédite, bouleverse les équilibres fragiles d’économies entières, et pourrait redessiner la carte géoéconomique de l’Afrique pour les années à venir.
Le Lesotho en première ligne
Symbole de ce choc tarifaire, le Lesotho petit royaume enclavé d’Afrique australe se retrouve frappé d’un droit de douane de 50 %, le plus élevé jamais appliqué à un seul pays. Ce coup porté à une économie totalement dépendante des exportations vers les États-Unis illustre la logique désordonnée des nouveaux arbitrages de Washington. En 2024, le Lesotho exportait près de 237 millions de dollars de biens vers les États-Unis, notamment des textiles pour Levi’s ou Wrangler, contre à peine 2,8 millions de dollars d’importations américaines. Résultat : une économie à genoux, victime collatérale d’une guerre économique où elle n’était pas censée être en première ligne.
L’AGOA sacrifiée sur l’autel du protectionnisme
Avec ce décret présidentiel, Trump met également fin à l’AGOA (African Growth and Opportunity Act), cadre commercial historique qui permettait à plus de 30 pays africains d’exporter vers les États-Unis sans droits de douane depuis 2000. Officiellement, l’AGOA devait expirer en septembre 2025. Mais l’agenda trumpiste n’aura pas attendu cette date, balayant ainsi deux décennies de rapprochement économique afro-américain.
Les conséquences sont d’ores et déjà visibles. Madagascar, autre bénéficiaire de l’AGOA, voit son industrie de la vanille qui représente 80 % de la production mondiale asphyxiée par des droits de douane de 47 %. La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, est frappée à 21 %. Autant de matières premières devenues plus chères pour le consommateur américain, sans réel bénéfice stratégique pour Washington.
Les paradoxes d’une politique incohérente
Ironie du sort, les plus gros exportateurs africains vers les États-Unis, à savoir l’Afrique du Sud et le Nigéria semblent relativement protégés par les failles du système. Pourquoi ? Parce que la plupart de leurs exportations sont des matières premières stratégiques : minéraux critiques dans le cas sud-africain, pétrole brut et gaz naturel dans le cas nigérian. Des produits aujourd’hui exemptés de taxes pour des raisons évidentes de dépendance énergétique américaine. Ainsi, les pays les plus fragiles sont les plus exposés, tandis que les géants en ressources naturelles bénéficient d’un bouclier implicite.
Un effet boomerang pour Washington
Au-delà du déséquilibre, c’est toute la rationalité économique de ces mesures qui interroge. De nombreux analystes alertent sur l’effet contre-productif de ces taxes. Loin de protéger l’industrie américaine, elles menacent de renchérir le coût de produits de grande consommation : jeans, chocolat, crème glacée, autant de biens qui intègrent des composants ou des ingrédients africains.
L’administration Trump s’isole d’un continent dont le potentiel commercial reste sous-estimé. En 2023, le commerce entre la Chine et l’Afrique atteignait 295 milliards de dollars, contre moins de 70 milliards avec les États-Unis. En punissant l’Afrique, Washington rompt un des rares leviers d’influence qu’il lui restait sur le continent.
La Chine, grande gagnante
Pékin, elle, avance ses pions. En 2023, la Chine a levé les droits de douane sur les produits en provenance de 33 pays africains, renforçant son image de partenaire plus prévisible et plus engagé. Dans un contexte d’hostilité croissante envers Washington, les capitales africaines regardent de plus en plus vers l’Est. En quelques années, la Chine est devenue à la fois investisseur, créancier, partenaire commercial et modèle de coopération politique pour une grande partie de l’Afrique.
Une réponse africaine s’organise
Loin d’assister passivement à ces bouleversements, certains pays africains tentent de réagir. Le Zimbabwe a proposé une ouverture totale de son marché aux produits américains en échange d’une levée des droits. L’Afrique du Sud, elle, multiplie les tentatives de dialogue. Le Nigéria a injecté 200 millions de dollars pour stabiliser sa monnaie après les turbulences tarifaires.
Mais au-delà des réponses individuelles, une dynamique régionale se dessine. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), projet phare de l’Union africaine, pourrait devenir une réponse stratégique face au protectionnisme occidental. Des voix comme celle de Jeremy Awori, PDG d’Ecobank, appellent à « créer un cadre plus simple pour commercer entre Africains eux-mêmes ».
Vers un nouvel ordre commercial ?
À long terme, cette rupture brutale avec Washington pourrait accélérer l’intégration commerciale intra-africaine, tout en consolidant l’influence de puissances concurrentes comme la Chine, l’Inde ou les Émirats. L’Afrique ne pourra toutefois pas éternellement compenser la volatilité du marché mondial par des alliances opportunistes. Elle devra construire sa résilience sur la base de chaînes de valeur locales, d’infrastructures connectées, et d’une diplomatie économique coordonnée.